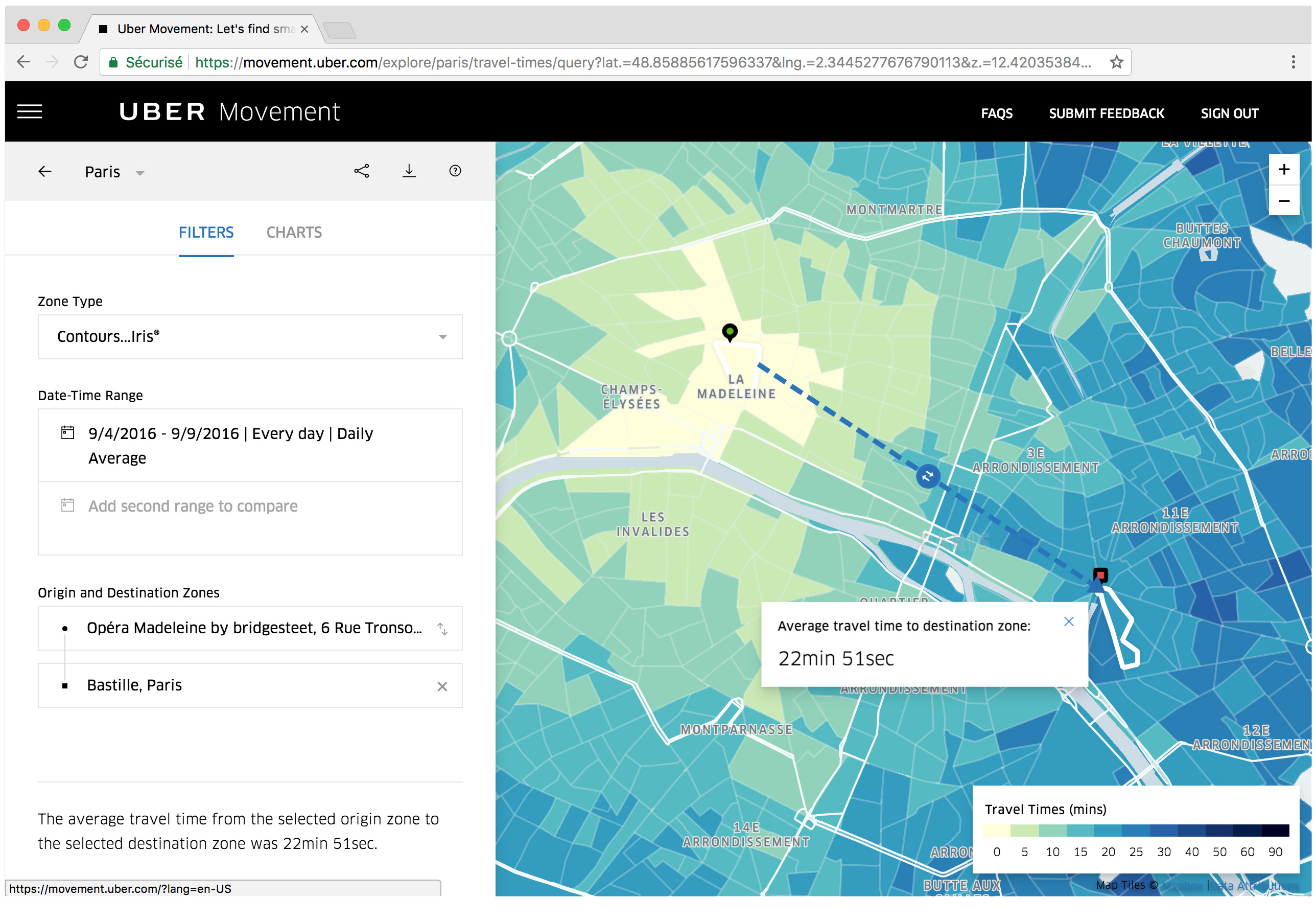L’Internet des objets – quand le numérique devient invisible
Les objets connectés ne sont certes pas nouveaux, mais leur apparition de plus en plus fréquente dans notre vie quotidienne nécessite de prendre le temps de questionner le statut de ces objets. En effet, après divers objets connectés valorisant la santé (balances, bracelets, etc.), les géants du numérique se livrent à présent un combat pour s’installer dans nos maisons, à l’image de Google Home, d’Echo proposé par Amazon ou encore de HomePod par Apple en ce qui concerne les enceintes connectées. Le numérique intègre ainsi de plus en plus de facettes de nos vies, rendant dans le même temps Internet de moins en moins visible, notamment par l’absence d’écran et la possibilité d’interagir directement avec la machine grâce à l’assistance vocale.
Mais comment ces objets s’intègrent-ils vraiment dans nos vies ? Et qu’est-ce que cela pourrait avoir comme incidence ? Pour reprendre Benghozi, Bureau et Massit-Folléa :
«la perspective est celle d’un monde de connexion encore plus dense, entre les hommes mais aussi avec les objets – une connexion permanente et de plus en plus invisible, qui engendre autant de craintes qu’elle est porteuse de promesses. » (2009, p.11)
Dans un premier temps, il sera nécessaire de faire un bref état des lieux de l’Internet des Objets (abrégé ci-après IdO, mais que nous retrouvons souvent sous sa forme anglaise, IoT, pour Internet of Things), d’en dessiner les contours. Par la suite, les aspects spatiaux et sociétaux seront éclairés, ainsi que les différentes précautions vis-à-vis des données récoltées par ces objets connectés. Enfin, les implications avérées ou éventuelles seront exposées.
Objets, Internet et Internet des Objets
Les objets ont toujours été des éléments communicants, porteurs de sens. Ce point a d’ailleurs été largement étudié par la sociologie de la traduction (Akrich, Callon et Latour, 2006), appelé par la suite la sociologie de l’acteur-réseau (SAR ou connu aussi sous l’acronyme ANT, pour Actor-Network Theory). L’élément important à retenir est la prise en compte à la fois de la technologie/des sciences, de la sociologie et des objets, ayant alors une capacité à agir (Callon, 1986). Dans son article « Objets communicants, avez-vous donc une âme ? », D. Boullier (2002) insiste par ailleurs sur le caractère communicant des objets, comme extension de soi, de nous sur les autres, mais également des autres sur nous. Ainsi, il déclare en parlant des objets:
« Chacun porte avec lui non seulement une prise sur le monde mais dans le même temps, autorise une emprise sur lui-même, sur sa sphère intime, qui est certes encadrée légalement mais qui lorsqu’on y réfléchit bien, est acceptée avec une grande aisance malgré son caractère profondément intrusif. » (ibid., p.53)
Écrit en 2002, le caractère intrusif des objets relevé par D. Boullier ne porte certainement pas sur l’IdO tel qu’il se développe aujourd’hui. Cependant, nous verrons que la protection de la vie privée est un élément important, autant pour Internet en général que pour l’IdO en particulier. Ce que relève également D. Boullier (2011), c’est la capacité des objets à devenir une seconde peau, à l’image de la carte bancaire qui est l’extension de nos possessions monétaires, qu’il nomme habitèle. Cette notion est importante car elle permet également de comprendre comment certains objets deviennent des « habitèles augmentés » (ibid., p.43) comme le téléphone portable, permettant de rassembler toutes (ou presque) nos appartenances. Cela nous mène à l’autre notion à introduire avant de s’intéresser à l’IdO à proprement parler, celle d’Internet. Si ce terme est largement répandu et ne nécessite pas de présentation, certaines de ses caractéristiques sont pertinentes à relever. Internet permet tout d’abord une permanence, c’est-à-dire la possibilité de stocker et de demander des informations. Cela s’oppose à la télévision ou la radio qui sont des flux et ne permettent donc pas d’accéder à l’information à la demande (Beaude, 2012). Par ailleurs, plus important encore, Internet rend possible une synchronisation (un temps commun) et une synchorisation (un espace commun), ce qui amène à avoir un réseau ubiquitaire (Beaude, 2015). Si Internet permet de s’affranchir de la contrainte de distance grâce à une communication quasi instantanée, il amène avec lui l’enjeu de l’immatérialité. Contrairement aux lieux territoriaux qui laissent voir les actions et les personnes impliquées (par exemple une foire éphémère), Internet demeure souvent invisible (Beaude, 2012).
Rassemblant alors les caractéristiques territoriales des objets et réticulaires d’Internet, l’Internet des Objets correspond à
« diverses solutions techniques (RFID, TCP/IP, technologies mobiles, etc.) qui permettent d’identifier des objets, de capter, stocker, traiter, transférer des données dans les environnements physiques mais aussi entre des contextes physiques et des univers virtuels. » (Benghozi, Bureau, Massit-Folléa, 2009, p.17)
Ces diverses solutions technologiques sont par ailleurs répertoriées dans le tableau ci-contre.

Il ne s’agit donc ni plus ni moins de la combinaison de plusieurs technologies existantes (Benghozi, Bureau et Massit-Folléa, 2009). La puce ou le capteur, en soi, sont inutiles tant qu’ils ne sont pas capables de communiquer avec d’autres éléments, raccordés au réseau Internet (Weill & Souissi, 2010). C’est pour la logistique que l’IdO a été tout d’abord intéressant, pour optimiser la gestion des marchandises grâce au scannage de puces passives (ibid.). Mais l’intérêt s’est très vite répandu à d’autres secteurs, comme les entreprises de transport qui l’utilisent dans les cartes d’abonnement ou les gouvernements dans les titres d’identité électroniques/biométriques (Rannou, 2013). Il est alors nécessaire de relever que contrairement aux ordinateurs ou aux smartphones qui permettent un large spectre d’usages, l’objet connecté est fabriqué pour un ou des usage(s) spécifique(s) (Saleh, 2017). P. Thebault explique également que le développement de l’IdO provient de « la banalisation des ressources informatiques et l’adoption des services Web par les utilisateurs » (Thebault, 2013, p. 15). Il semblerait donc que l’IdO réponde à une demande des consommateurs d’être de plus en plus connectés et en même temps, « c’est dans les activités les moins vitales de notre existence qu’Internet est devenu essentiel » (Beaude, 2012, p.61). En effet, les objets connectés disponibles pour le consommateur lui permettent souvent de créer de nouveaux besoins ou de lui faciliter la vie, mais rarement de la changer de manière radicale.
(conférence Ted pour une présentation plus détaillée de l’IdO, de son fonctionnement et de ses enjeux)
Objets situés, Internet distribué
Comme nous venons de le présenter, l’Internet des objets présente deux caractéristiques, celle d’être ancré territorialement, pour un usage spécifique, et celle d’être en même temps relié à un espace réticulaire avec lequel il interagit en permanence.
Plusieurs enjeux sont alors à mettre en évidence. Dans un premier temps, comme nous l’avons évoqué, nous avons un rapport particulier aux objets. Ceux-ci ne sont pas neutres et impactent nos comportements. D. Boullier (2002) évoquait par exemple le cadeau que nous n’osons pas jeter, car il est l’extension de la personne qui nous l’a offert. Dans le cas de l’IdO, la communication est encore plus importante car il y a une relation plus équilibrée entre les objets et les humains, dans le sens où nous agissons sur ces objets, mais que ceux-ci répondent à nos besoins de manière individualisée et influencent donc plus profondément nos comportements.

Exemple de bracelet fitbit
Par exemple, les bracelets fitbit informent son porteur sur son activité physique et son sommeil, ce qui amène très probablement l’individu à modifier son comportement. Avec des objectifs à atteindre et des récompenses (notifications positives) lorsque ceux-ci sont remplis, l’individu est bien encouragé à adopter certains comportements. Ceux-ci peuvent être auto-définis (par exemple une distance journalière à parcourir) ou calqués sur des savoirs experts (par exemple le temps et la qualité du sommeil). Il s’agit bien d’une peau permanente comme D. Boullier (ibid.) le préconisait, où l’objet est une prolongation de soi-même.
Mais si cela ne posait que peu de problèmes pour les objets qui communiquent de manière indirecte, cela se complexifie avec l’IdO. En effet, celui-ci communique directement, non seulement avec les individus, mais également avec Internet, donc avec les acteurs fournissant le service de l’objet et recevant de ce fait les données récoltées. Les enjeux en termes de protection des données et de vie privée sont alors à prendre au sérieux. Au niveau européen, le groupe Article 29 a instauré les principes de base :
« […] la collecte doit avoir un objet précis et ne doit concerner que les informations pertinentes ; la durée de conservation des données doit être justifiée par rapport à la réalisation de cet objet. » (Benghozi, Bureau et Massit-Folléa, 2009, p.75)
La collecte et l’utilisation des données devraient donc être bien encadrées. Cependant, en pratique, les acteurs du numérique qui récoltent ou utilisent trop de données arguent qu’il s’agit d’une erreur et écopent d’une sanction moindre, car une trop grande amende affecterait le développement de l’économie du numérique (Beaude, 2012). Du côté des utilisateurs, plusieurs stratégies peuvent être identifiées concernant la collecte des données. Certains optent pour l’idée que si nous n’avons rien à nous reprocher, alors nous n’avons rien à cacher. Ils ne voient donc pas de problème à ce que leurs données soient récoltées. Mais l’IdO touchant de plus près à l’intime, à la personne directement ou à son environnement, comme son foyer, il semble que la sécurité soit un point important pour une majorité de personnes. En effet, la presse regorge d’articles relatant des failles de sécurité, plus ou moins préjudiciables, engageant également l’IdO (quelques exemples sont disponibles dans l’article Les dangers de l’Internet des objets (IoT)). Bien que certains puissent croire qu’il est possible d’éviter ou de contrôler les traces, ce n’est qu’une illusion (Boullier, 2016). Il est donc nécessaire d’apprendre à les maîtriser (Beaude, 2012). Toutefois, pour obtenir le consentement du consommateur à la collecte de ses données, il est possible de « faire du client un acteur entièrement intégré dans le marché » (Allard, 2016, p.130). L. Allard (2016) fait par exemple référence au contrat d’assurance d’une voiture qu’il sera possible de négocier grâce aux traces antérieures. Cependant, si cette opportunité peut être parfois bénéfique, nous pouvons tout aussi penser que certains acteurs, et notamment les assurances, y verront un moyen de se désengager un maximum (voir l’article Alarmed By Admiral’s data grab ? Wait until insurers can see the contents of your fridge). La question de qui a accès aux données que nous laissons et de ce qu’ils en font est donc primordial. C’est ce que nous allons discuter à présent.
Mesurer le quotidien
Comme évoqué, toutes pratiques numériques laissent une trace, une donnée, qui est trop souvent prise comme brute par les spécialistes de la technologie (ingénieurs, physiciens, etc.). L’objectif ici est alors d’interroger ces traces afin de mettre en garde contre certaines volontés parfois simplificatrices.
Les traces laissées par l’IdO peuvent être multiples. Géolocalisation, son, vidéo, battements de cœur, qualité de l’air, pour n’en citer que quelques-uns, sont autant de données différentes pouvant être obtenues grâce aux différents objets connectés. Chacune de ces données permet d’accéder à une certaine information, spécifique, mais le but ici est de rester à un niveau général. En comparaison avec d’autres traces, et notamment celles fréquemment utilisées des réseaux sociaux où il faut prendre en compte l’intentionnalité de l’individu et la mise en scène de sa propre existence (Beaude, 2015), les données récoltées par les capteurs de l’IdO peuvent paraître neutres. En effet, comme tout scientifique sur le terrain, les capteurs relèvent, mesurent leur environnement.

Image postée sur Facebook par la page VDM le 2 janvier 2018
Mais deux enjeux sont importants à relever : le contexte de la production des traces et l’utilisation de celles-ci. En ce qui concerne le contexte, les capteurs sont par définition disposés à ne recueillir que les données correspondantes à leur usage. Ainsi, si nous reprenons les bracelets ou montres connectés, ils ne prendront en compte que l’activité de l’individu, et non le contexte, ce qui peut donner des situations cocasses comme illustré ci-contre. Mais cela permet de voir également le côté performatif de ces objets. En effet, si nous voulions atteindre un objectif d’activité sans eux, nous opterions certainement pour du sport, pour plus de trajets à pied et pour les escaliers plutôt que l’ascenseur. Nous aurions finalement notre quota d’activité, variable selon les aléas de la journée, et de nombreuses actions ne seraient pas comptabilisées comme de l’activité (par exemple les déplacements dans son propre logement). Avec les objets connectés, notre activité entière est calculée, réduite à des chiffres, indépendamment de ce que nous faisons. Mais l’absence de contexte n’est pas forcément problématique. De nombreux objets connectés sont très efficaces quand ils touchent à l’environnement où l’homme n’est qu’un élément. C’est notamment le cas de plusieurs éléments de la smart city, comme l’éclairage intelligent qui permet de diminuer l’intensité lumineuse lorsque personne ne se trouve à proximité. Mais cela devient plus compliqué lorsque l’homme est l’objet d’étude, car il n’est pas stable et il est pris dans un environnement qui dépasse la proximité (Boullier, 2016). Cela peut laisser supposer que l’évolution de l’IdO vers des objets qui ne font plus seulement de capter, mais qui permettent également une adaptation et une individualisation, notamment grâce au deep learning, engage de nouvelles réflexions.
Quel monde pour demain ?
L’IdO permet de collecter un nombre important de données et peut alors entrer dans la catégorie de big data . Cependant, la quantité astronomique de données récoltées doit être couplée avec une plus grande qualification, afin d’ancrer ces données dans un contexte et en sortir des interprétations plus fines. (Venturini, Cardon & Cointet, 2014).
Le problème actuel de l’IdO est alors qu’il semble répondre plus à une logique de sciences dures que de sciences sociales, dans le sens où nous retrouvons une préférence pour les méthodes quantitatives mais surtout la volonté de voir pour prévoir, largement discuté par Auguste Comte (1842). Le problème provient du fait que les sciences dures sont stables. Dans les mêmes conditions, nous aurons alors normalement toujours le même résultat. En sciences sociales cependant, l’environnement est en constante évolution, les résultats des études entrant eux-mêmes dans la transformation de la société par effet performatif ou au contraire comme inhibiteurs. Il n’est donc pas rare de rencontrer des résultats solides, mais n’informant finalement que très peu sur ce que les gens font, à l’image de l’étude sur la mobilité de C. Song et al. (2010) qui annonce pouvoir prédire les déplacements des gens dans 93% des cas, alors qu’il s’agit principalement des trajets du domicile au travail, ou dans un rayon proche du domicile. Cela amène à repenser également à la théorie de Gabriel Tarde (1895) qui évoquait la possibilité que tout devienne quantifiable avec les statistiques, au risque de se contenter de l’imitation.
« Mais nous savons par tout ce qui précède que la statistique est circonscrite dans le champ de l’imitation et que celui de l’invention lui est interdit. L’avenir sera ce que seront les inventeurs, qu’elle ignore, et dont les apparitions successives n’ont rien de formulable en loi véritable. » (Tarde, 1895, p.155)
Si à l’époque de Gabriel Tarde, les statistiques constituaient une nouveauté dans la façon d’appréhender le monde, aujourd’hui elles ont été remplacées par la profusion de données numériques. L’engouement pour les traces au plus proche de l’espace territorial, comme notamment la géo-localisation, laisse penser qu’il en est de même pour l’IdO, qui permet en effet d’avoir une abondance de mesures très précises.
Le problème cependant à rester dans une logique de voir pour prévoir est dans l’usage que l’IdO commence à avoir. L’exemple du frigo intelligent qui détecte tout seul un produit fini et le recommande n’est déjà plus au stade de la fiction. Cela entraînera certainement une transformation du marketing par exemple, domaine pour lequel l’innovation et la découverte est primordiale. En effet, la machine ne sera pas sensible à un nouveau produit, alors que nous aurions éventuellement testé celui-ci grâce à la publicité, au packaging ou à une mise en évidence dans les rayons du magasin (Ouellet, 2016). À termes, d’après J.-F. Ouellet (ibid.), le commerce de détail de type télique (recherche de produits particuliers) disparaîtrait pour ne laisser que le magasinage paratélique, ou lèche-vitrine, qui serait beaucoup plus axé sur l’expérience, sur une mise en scène des centres commerciaux où nous ne viendrions pas uniquement acheter un produit, mais surtout vivre une expérience. L’autre transformation susceptible de voir le jour avec la possibilité de prévoir nos actions grâce aux traces récoltées par l’IdO concerne la politique. En effet, avec ce type de logique, nos actions détermineraient l’organisation politique à venir. Or, pour reprendre B. Beaude:
«la prédiction algorithmique de l’avenir sur la base des actes passés ne serait-elle pas la négation même de la politique, à savoir le choix d’un avenir parmi des options non déterminées ? » (Beaude, 2015, p.153)
Conclusion
L’IdO a beaucoup évolué ces dernières années et intègre de plus en plus nos vies, sans que nous en soyons toujours vraiment conscients. Cependant, derrière ces objets, les traces que nous laissons contribuent à alimenter des bases de données et il est important de prendre du recul.
« Ce qu’il faut interroger, c’est avant tout la confiance que nous avons en des acteurs privés de plus en plus puissants, dont l’activité, les motivations et les orientations ne relèvent pas de la politique telle que nous l’avons développée dans les sociétés démocratiques contemporaines. Nous assistons à l’émergence d’acteurs qui produisent et maîtrisent une part croissante de l’espace de notre quotidien, de notre travail, de nos loisirs, de nos revendications, de nos collaborations et de notre coordination. » (Beaude, 2012, p.111)
Parmi les grands acteurs, nous retrouvons les géants du numérique comme Google, Apple ou encore Amazon. Cette nouvelle source de données peut renforcer l’effet de panoptique, largement développé par S. Bentham et M. Foucault, qui consiste, de manière très résumée, à surveiller continuellement sans être vu (Foucault, 1975 ; Dorrestijn, 2006). Cette position stratégique peut permettre d’induire certains comportements chez l’individu surveillé, ce qui explique que le panoptique a été développé notamment dans le but de réformer la prison et d’instaurer une discipline (Dorrestijn, 2006). La question de la maîtrise de qui a accès à ses données et de ce qui en est fait est donc primordiale pour éviter d’éventuelles dérives. Ceux qui pourraient penser que nous subissons la technologie et que nous n’avons pas de marge de manœuvre ont tort. «No technology is, has been, or will be a “natural force.” Nor will any technology by itself break down cultural barriers and bring world peace.»1 (Nye, 2006, p.19). L’IdO a beaucoup de potentialités, il permet entre autres d’alléger notre quotidien et de participer à une optimisation des ressources. En ce qui concerne la compréhension de la société toutefois, il est important d’intégrer les sciences humaines et sociales, car les données elles-mêmes, autant précises et abondantes qu’elles soient, ne produisent pas forcément du sens (Benghozi, Bureau & Massit-Folléa, 2009).
Bibliographie
AKRICH, M., CALLON, M. & LATOUR, B. (2006). Sociologie de la traduction : Textes fondateurs. Paris : Presses des Mines.
ALLARD, L. (2016). Dans quel monde voulons-nous être connectés ? Transhumanisme vs Companionism. Nectart, 2 (n°3), pp.125-132.
BEAUDE, B. (2012). Internet. Changer l’espace, changer la société. Limoges : FYP.
BEAUDE, B. (2015). Spatialités algorithmiques. In M. Severo et A. Romele (dir.), Traces numériques et territoires, les débats du numérique (pp.133-160). Paris : Presses des Mines.
BENGHOZI, P.-J., BUREAU, S. & MASSIT-FOLLÉA, F. (2009). L’Internet des objets – Quels enjeux pour l’Europe ? Paris : Éditions de la maison des sciences de l’homme.
BOULLIER, D. (2002). Objets communicants, avez-vous donc une âme ? Enjeux anthropologiques. Les cahiers du numérique, 4 (vol.3), pp.45-60.
BOULLIER, D. (2011). Habitèle virtuelle. Urbanisme, Publications d’architecture et d’urbanisme, pp. 42-44.
BOULLIER, D. (2016). Sociologie du numérique. Paris : Armand Colin.
CALLON, M. (1986). Éléments pour une sociologie de la traduction. La domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins-pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc. L’Année sociologique, 36, pp. 169-208.
COMTE, A. (1842). Discours sur l’esprit positif. Suivi de cinq documents annexes. Repéré à http://classiques.uqac.ca/classiques/Comte_auguste/discours_esprit_positif/Discours_esprit_positif.pdf
DORRESTIJN, S. (2006). Le panoptique chez Bentham et Foucault. Repéré à www.stevendorrestijn.nl/downloads/PanopticonBenthamFoucault.pdf
FOUCAULT, M. (1975). Surveiller et punir. Paris : Gallimard.
NYE, D. (2006). Technology Matters : Questions to Live with. Cambridge, Massachusetts : The MIT Press. Repéré à https://polifilosofie.files.wordpress.com/2012/12/technology-matters-questions-to-live-with-david-e-nye.pdf
OUELLET, J.-F. (2016). La révolution de l’intelligence connectée – l’Internet des objets et le marketing en ligne 4.0. Gestion, 41, pp.84-88.
RANNOU, H. (2013). L’Internet des objets : d’une vision globale à des applications bien plus éparses. Annales des Mines – Réalités industrielles, 2, pp.70-73.
SALEH, I. (2017). Les enjeux et les défis de l’Internet des Objets (IdO). Internet des objets, 1, pp.1-8.
SONG, C., QU, Z., BLUMM, N. & BARABÁSI, A.-L. (2010). Limits of Predictability in Human Mobility. Science, 327, pp. 1018-1021.
TARDE, G. (1895). Les lois de l’imitation (2e éd.). Paris : Éditions Kimé.
THEBAULT, P. (2013). La conception à l’ère de l’Internet des Objets : modèles et principes pour le design de produits aux fonctions augmentées par des applications (Thèse de doctorat, École nationale supérieure d’arts et métiers – ENSAM, Paris). Repéré à https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00869385/file/THEBAULT_-_Pierrick.pdf
VENTURINI, T., CARDON, D. & COINTET, J.-P. (2014). Méthodes digitales. Approches quali/quanti des données numériques. Réseaux, 6 (n°188), pp.9-21.
WEILL, M. & SOUISSI, M. (2010). L’Internet des objets : concept ou réalité ? Annales des Mines – Réalités industrielles, 4, pp.90-96.